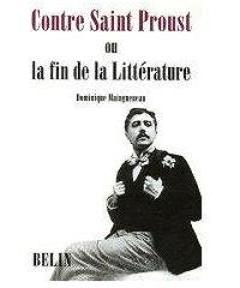Les éditeurs dépriment, les libraires agonisent, les auteurs crient famine. Et pourtant la machine tourne à plein régime : 727 romans publiés cette saison, contre 683 l’an dernier. On progresse… Les uns veulent voir dans cette production exponentielle « le signe de la vitalité du secteur » (Rapport livre-2010). Les autres n’hésitent plus à comparer les éditeurs à des éboueurs et parlent de « Tri sélectif » (titre de l’édito de Livres Hebdo du 29 juin).
Et c’est bien de cela qu’il s’agit. Le marché de l’édition est devenu une vaste déchetterie, un abattoir où l’auteur fait figure de chair à canon et le lecteur de dindon de la farce. Au lieu de remplir sa fonction de médiation, la chaîne du livre ne se préoccupe plus que de sa propre tuyauterie. La distribution est devenue une fin en soi – un centre de profit indépendant qui constitue désormais le cœur du système. Peu importent les intérêts de l’auteur et du lecteur. L’essentiel est d’alimenter la turbine et de générer du trafic – même si celui-ci se résume de fait aux allers et retours d’invendus (1).
Les discours en vogue sur les turpitudes de l’édition française mettent volontiers en cause le capitalisme triomphant, la course effrénée au profit, la marchandisation de la culture… Argument un peu court, quand on sait à quel point le Milieu, barricadé derrière son « exception culturelle », se complait dans des pratiques défiant toute logique économique. « L'édition est la seule activité qui répond à la baisse de la demande par une augmentation de l'offre », disait jadis Jérôme Lindon. C’est aussi et surtout le seul secteur où le principal créateur de valeur - l’auteur – est le plus mal traité : rémunération dérisoire, confiscation intégrale et illimitée de tous les droits d’exploitation de son travail, alors que c’est lui qui en assure la conception, la création (à moins d’avoir un nègre), le financement (à moins d’avoir un mécène), la fabrication (du moins en partie, traitement de texte oblige) et la promotion (à moins d’avoir une doublure de type Emile Ajar)... Au lieu de miser sur le contenu, c’est-à-dire sur l’auteur, la chaîne du livre préfère investir dans le contenant et jouer à la loterie en multipliant les tirages. Exit les passeurs de littérature, place aux marchands de papier !
Dans ce système, l’écriture en tant que telle n’a plus aucune valeur. Et l’inflation de titres à laquelle on assiste aujourd’hui représente en quelque sorte la phase terminale du processus de dévalorisation analysé par Marx (William, pas Karl) dans son ouvrage L’adieu à la littérature (Editions de Minuit, novembre 2005) :
« La valeur de la littérature ne cessa de croître entre le XVIIe et la première moitié du XIXe siècle. La société lui confia des missions toujours plus importantes. Simple amuseur de la cour au début de la période considérée, tout juste bon à participer au divertissement royal ou, dans le meilleur des cas, à mettre en scène la gloire du souverain, l’écrivain gravit peu à peu les échelons du pouvoir et de la reconnaissance publique jusqu’à une métamorphose complète : le serviteur des princes devint la lumière du monde. De cette évolution un signe ne trompe pas : le changement de statut symbolique de la littérature s’accompagna au cours du XVIIIe siècle de l’émergence du statut juridique de l’auteur. Il était naturel que celui-ci pût affirmer ses droits au moment même où la littérature se voyait investie de pouvoirs nouveaux.
L’échange fonctionna en ces termes : plus les écrivains prétendaient donner du sens à la société – ce même sens que la religion n’était plus en mesure d’offrir -, plus la société leur conférait en son sein une responsabilité et une place éminentes. Mais la situation était instable : le sens offert par la littérature était lui-même garanti par la position qu’elle occupait dans la hiérarchie sociale. Que, d’une manière ou d’une autre, le marché s’estimât trompé sur la qualité de la marchandise fournie, c’est-à-dire sur la capacité des textes littéraires à faire sens pour lui, ou qu’il trouvât exagérées les prétentions de la littérature à la reconnaissance symbolique, et tout l’édifice s’écroulerait comme un château de cartes. » (P 61-62)
On en est là. Le krach a bien eu lieu. La cotation des actifs est au plus bas - rendant du même coup possible les OPA à bon compte (comme l’a montré la Littellmania l’an dernier). Inutile de chercher à « tout reprendre », à « tout recommencer depuis le début ». La refondation littéraire que certains appellent de leurs vœux est aussi chimérique que la refondation sociale chère au Medef ou la refondation politique prônée par le PS. Le bon vieux temps de l’étalon-or est révolu. Bienvenue dans un monde de changes flottants. « De la littérature qui vient, souligne W. Marx, nul en fait ne peut rien savoir d’absolument certain. Ni les fonctions qu’elle remplira, ni la forme qu’elle adoptera, ni même le nom qu’elle portera. » Tout au plus peut-on suggérer ici quelques pistes de réflexion sur la mutation en cours, en s’interrogeant non seulement sur le contenu et les enjeux de l’écriture, mais aussi sur son économie et ses nouveaux modes de diffusion.
(1) Pour la critique détaillée de cette machinerie kafkaïenne, lire Le cauchemar de Diderot, la littérature en librairie aujourd’hui de Jean-Pierre Ohl, libraire et écrivain, in l’ouvrage collectif L’édition littéraire aujourd’hui, sous la direction d’Olivier Bessard-Banquy (Presses Universitaires de Bordeaux).